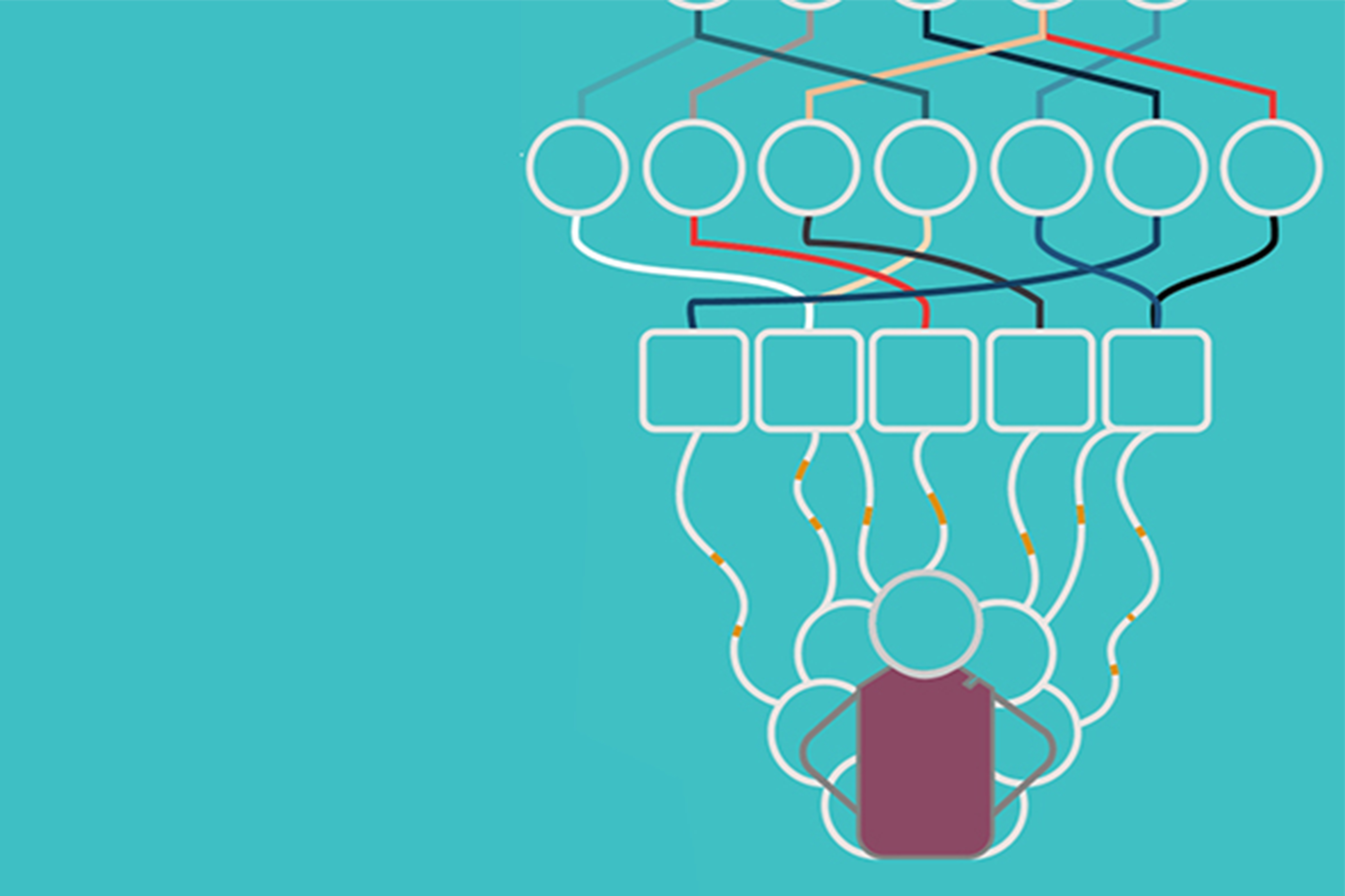Colloque
Du 11 octobre 2023 au 12 octobre 2023
Session II : CORPS, COGNITION ET DANSE
Après le succès, les 19 et 20 mai 2022 à l’UGA, d’un premier colloque international ayant posé les fondements nécessaires à la définition de l’esthétique incarnée en contexte artistique et tracé les contours de ses différents enjeux et domaines d’application, cette seconde édition, prévue les 11 et 12 octobre 2023 à l’UGA, porte l’ambition de se concentrer plus spécifiquement sur les liens entre corps, cognition et danse. Il s’agit d’établir un dialogue fécond et interdisciplinaire, encore trop rarement proposé, entre chercheur·euse·s en esthétique incarnée, théoricien·ne·s et praticien·ne·s de la danse. Comment les domaines de l’esthétique incarnée (embodied aesthetics) et de la recherche en danse (dance studies) peuvent-ils penser et agir ensemble ? Que peuvent-ils se transmettre mutuellement ? En réunissant des philosophes, chercheur·euse·s en arts du spectacle, artistes-chorégraphes, interprètes, neurobiologistes, l’événement placera la dynamique science-art-vie en son centre.
La définition la plus générale que l’on puisse donner de l’esthétique incarnée1 en contexte artistique est certainement celle-ci : c’est une approche qui ne détache pas le processus artistique du travail du corps, et qui affirme que les processus cognitifs qui y sont mobilisés sont, en partie au moins, constitués par des structures et processus extra-cérébraux. Dans cette perspective, une première question fondamentale se pose : si le corps est ouvertement sollicité dans la création en danse – en tant qu’il appartient tant aux moyens qu’aux fins chorégraphiques –, qu’en est-il dans l’acte de réception ? Dans le champ de l’esthétique incarnée appliquée aux arts, notamment dans l’esthétique incarnée des arts visuels et plastiques, c’est en effet le phénomène de réception esthétique qui a été le plus étudié. Lorsque le ou la destinataire de l’œuvre est revendiqué incarné.e, c’est le plus souvent parce qu’on l’estime indissociable, certes bien sûr d’un corps extra-cérébral, c’est-à-dire indissociable des propriétés constitutives du corps affectif, vivant, vécu et actif, mais aussi comme indissociable d’un environnement avec lequel il ou elle entre en interaction. Ce faisant, le phénomène d’expérience esthétique incarnée, que proposent par exemple Paul Crowther, Mark Johnson, Alva Noë, Alfonsina Scarinzi, Richard Shusterman, Bruno Trentini ou Wolfgang Tschacher, n’est que rarement une expérience purement incarnée au sens étroit d’une liaison essentielle du système cognitif à un système biologique vivant auto-organisé, auto-poïétique et autonome. Il suppose non moins une ouverture constitutive et active sur le monde. Chez Shusterman, l’expérience esthétique est une véritable praxis corporelle qui fait du corps esthétisé un « lieu d’expérience et de signification2 » dans l’action. Chez Crowther, la réception d’une œuvre est incarnée en raison de la réciprocité ontologique qui se joue entre le sujet esthétique et le monde dans une perspective écologique. Chez Noë, cette expérience est incarnée car elle est fondamentalement perceptuelle, étant entendu que la perception est un acte sensorimoteur. Chez Scarinzi, on retrouve une théorie active de la perception esthétique et plus largement une approche non seulement incarnée, mais aussi contextuelle et dynamique de l’expérience esthétique.
Dans ce colloque, nous souhaitons : d’une part, continuer à interroger la conception esthétique adossée au cadre théorique général de la cognition incarnée, en l’appliquant au cas spécifique de la danse, de la création d’une chorégraphie à sa réception, en passant par l’élaboration et la ransmission d’une technique, ou encore par les pratiques de training et d’improvisation3 ; d’autre part, interroger les théoricien·ne·s et praticien·ne·s de la danse sur leur propre interprétation d’une pensée qui serait incarnée, ainsi que sur l’expression ou l’exploration de cette dernière dans leur art ; et enfin, favoriser l’échange interdisciplinaire dans une perspective d’enrichissements et d’apprentissages réciproques.
Plus précisément encore, ce colloque international interdisciplinaire porte trois ambitions principales :
1) envisager et sonder les différentes applications de la théorie générale de l’esthétique incarnée en danse, sous la forme, par exemple, d’études de cas artistiques ou d’expérimentations directes. Une analyse des études relativement récentes menées sur le rôle des neurones miroirs dans l’appréhension de la danse sera ici particulièrement la bienvenue. L’idée soutenue est, dans ce domaine, la suivante : si je suis face à un spectacle de danse sans que je ne sois moi-même versé.e dans la pratique de la danse, je peux malgré tout me faire une idée des compétences implicites requises dans l’exécution des mouvements proposés et y trouver une forme de plaisir. Cette compréhension automatique, presque instinctive, se définit comme une forme de compréhension du corps par le corps, comme une forme de connaissance pratique (know how) qui place du cognitif sur le terrain même du corps préconscient.
2) Interroger les théoricien·ne·s et praticien·ne·s de la danse sur leurs pratiques et leurs conceptions d’une pensée incarnée. Une question se pose dans ce contexte : si, en philosophie de l’esprit, le mind-body problem précède largement l’émergence des sciences cognitives – et plus encore, naturellement, leur tournant dit incarné –, qu’en est-il de cette question dans les dance studies ? On sait par exemple que Mabel E. Todd a mené, au début du XXème siècle, une étude particulièrement influente sur les effets réciproques de la pensée et du corps dans le champ de la danse (Le corps pensant, 1937) et des pratiques psychosomatiques. Alors, pourquoi le champ de la cognition incarnée ne touche-t-il finalement que de loin la recherche en danse ? Est-ce parce que cette idée que la danse est une pratique incarnée est trop évidente pour être interrogée et théorisée ?Est-ce plutôt parce que les dance studies ne voient pas l’intérêt d’un dialogue avec les sciences cognitives ? Est-ce encore parce que le champ très anglo-saxon de l’embodied aesthetics n’a pas encore atteint celui de la recherche en danse et, par extension, des dance studies ? Bref, l’expression embodied dances pourrait-elle faire sens ?
3) Proposer plusieurs temps de partages et d’échanges multimodaux. Articulées aux conférences, des tables rondes (et tournantes) entre les chercheur·euse·s permettront de mettre à l’épreuve de l’interdisciplinarité quelques-uns des thèmes majeurs mobilisés dans l’esthétique incarnée : l’expérience phénoménologique ou micro-phénoménologique, l’empathie émotionnelle, le pathique, les liens de continuité entre l’expérience incarnée et la pensée abstraite, la cognition sociale, la simulation incarnée, les neurones miroirs, la proprioception, la kinesthésie, l’ideokinesis, etc. Des temps de performance et des workshops se proposeront en outre de mettre la théorie de l’esthétique incarnée en pratique et d’associer ainsi aux moments d’analyse conceptuelle des temps d’expérimentation vécus en chair et en corps. Ces trois objectifs se combinent à une ambition générale de plus grande envergure : continuer à faire connaître la ligne de recherche, à la fois jeune et prometteuse, de l’esthétique incarnée en contexte artistique, en proposant un deuxième acte de cette première manifestation scientifique lui étant dédiée en France.